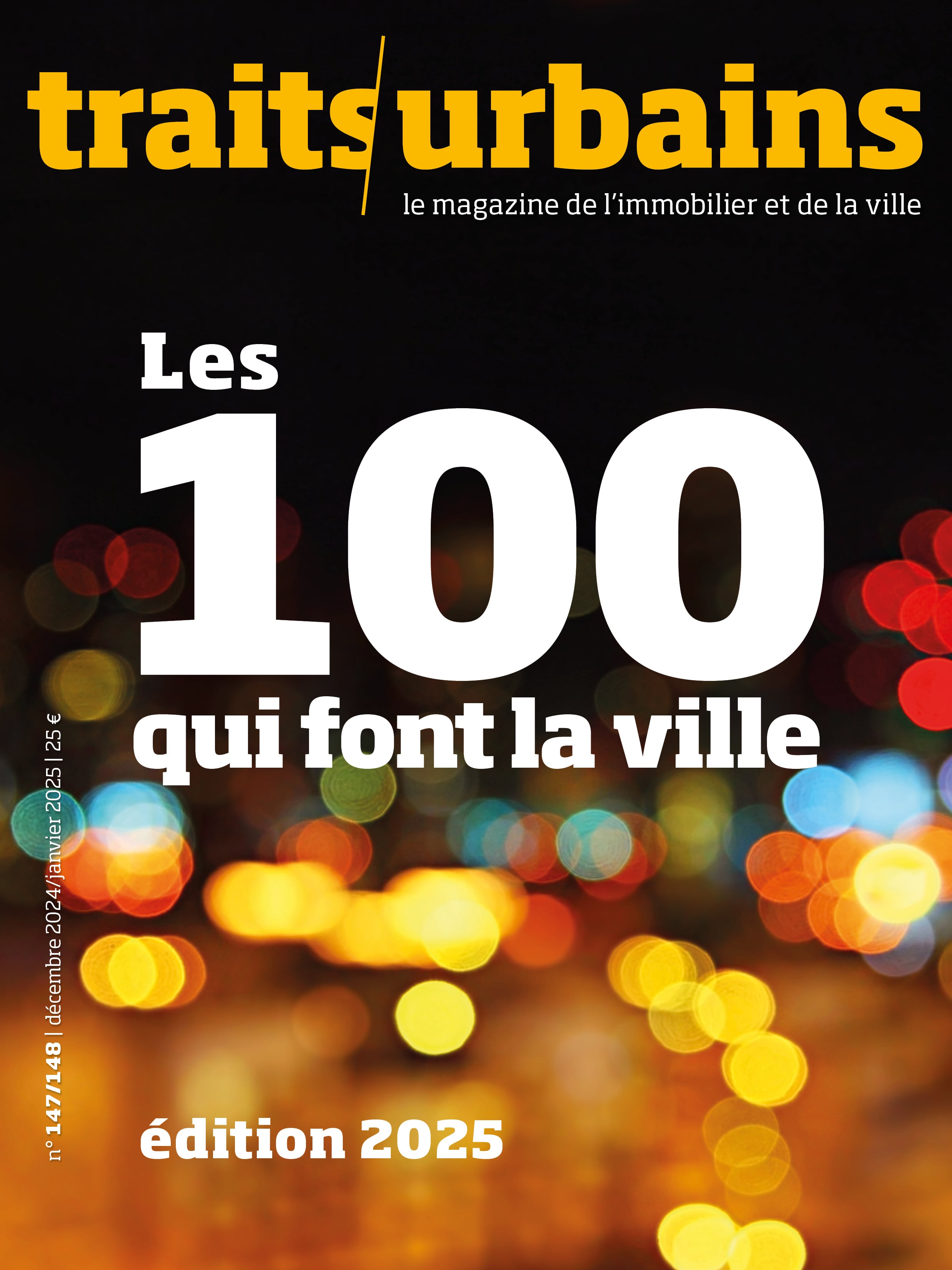ACTEURS
VIDÉOS
TENDANCES

Repenser Paris pour la protéger de la chaleur
Pour la 2ème conférence du cycle des « conversations sur la ville », la coopérative Plateau Urbain en partenariat avec Surface+Utile, Vraiment Vraiment, Bellevilles, Le Sens de la Ville, Yes We Camp, Bellastock, Encore Heureux, tous occupants du tiers-lieu Césure, a mis en avant le thème de l’adaptation aux canicules à Paris.
Animée par Raphaëlle Chaygneaud-Dupuy, responsable vie de la coopérative et sociétariat au sein de Plateau Urbain, la conférence a fait dialoguer Alexandre Florentin, conseiller de Paris et président de la mission « Paris à 50°C » et Marie d’Oncieu, architecte à l’agence h2o architectes. Le format choisi se voulait original : en partant du sous-sol et en décrivant successivement le rez-de-chaussée, les étages, les combles et le toit, il s’agissait d’imaginer un immeuble résidentiel parisien adapté à une température de 50°. Pour Raphaëlle Chaygneaud-Dupuy, cette méthode permet de « cheminer sur une ligne de crête entre imagination et faisabilité ».
Marie d’Oncieu a d’abord rappelé que Paris est une des villes les plus denses du monde ce qui génère de la chaleur et rend difficile de ventiler l’espace urbain. Or si l’air ne circule pas, la température ne peut pas baisser, créant un dôme de chaleur au-dessus de la ville. Cette architecture particulière à Paris a été pensée pour un climat stable dans le temps et plus froid que celui que nous connaissons ce qui fait de Paris « une ville particulièrement vulnérable » d’après Alexandre Florentin.
Face à la chaleur, pouvons-nous trouver refuge en sous-sol ? Marie d’Oncieu considère qu’ils ne sont pas « quelque chose sur lequel on a l’habitude de travailler en tant qu’architecte ». Pourtant il est possible « d’inventer des locaux communs en sous-sol afin qu’on s’y rafraichisse » pour peu que la ventilation y soit efficace. En dehors des sites purement résidentiels, Alexandre Florentin souligne que certains espaces en sous-sol pourraient servir à se rafraîchir à Paris. Les parkings, les églises (ou même les catacombes pour les plus courageux) apportent des « topologies de surfaces intéressantes en période de crise ». De même la partie enterrée du canal Saint-Martin aujourd’hui inaccessible aux piétons pourrait offrir une surface fraîche et lumineuse mais protégée du soleil.
Au niveau des rez-de-chaussée se concentrent les conflits d’usages potentiels entre habitants et commerçants. Face à la chaleur, certains magasins pourraient décider d’utiliser la climatisation ce qui va refroidir l’intérieur mais réchauffer l’extérieur, une décision acceptable pour Alexandre Florentin s’il s’agit de protéger des produits périssables comme de la nourriture mais qui ne peut pas être généralisée sur tous les magasins. Il est donc nécessaire de débattre d’un « droit à la fraîcheur » pour certaines personnes et activités. Les rez-de-chaussée ont également un potentiel de ventilation assez fort et, comme le rappelle Marie d’Oncieu, le bâti ancien avait « des systèmes de ventilation très intelligents » (trappes et conduits permettant la circulation de l’air notamment) qui ont été rendus inutilisables par les réhabilitations successives. Les cours d’immeubles au sol sont également une source de végétalisation potentielle qui permettrait de créer des îlots de fraicheur.
Dans les étages, la priorité pour Marie d’Oncieu est d’isoler thermiquement les bâtiments. Beaucoup de façades parisiennes sont cependant protégées pour leur intérêt patrimonial, rendant difficile l’isolation par l’extérieur. Il est toutefois possible d’isoler les murs qui donnent sur les cours d’immeubles ou d’isoler par l’intérieur. Il faut également repenser l’orientation des logements, et permettre de laisser la porte ouverte dans les logements mono-orientés pour créer des courants d’air. Alexandre Florentin propose d’expérimenter pour transformer les escaliers et cheminée de certains bâtiments en « tours à vent » (élément traditionnel de l’architecture iranienne qui capte les vents et permet de rafraichir des espaces).
Les combles parisiens quant à eux concentrent une grande partie des problèmes de chaleur. Marie d’Oncieu rappelle que le foncier limité à Paris a conduit à transformer en logement ces combles qui n’avaient pas été pensés pour cela. Leur trop grande exposition aux hautes températures pourrait pousser à les rendre inhabitables et à leur donner d’autres usages comme du stockage. Alexandre Florentin propose tout de même l’obligation d’y installer des stores sur les Velux.
Enfin, les toitures parisiennes sont, pour une grande partie, en zinc, un matériau peu isolant mais qui fait partie de l’identité architecturale de la capitale. Sur les toits pentus il est cependant possible d’installer des terrasses végétalisées sur le modèle des « altanes » vénitiennes (une structure en bois posée par-dessus la pente). Pour les toits planes, la végétalisation et l’installation d’ombrelles photovoltaïques permettent également de protéger le reste du bâtiment de la chaleur.
EE
- Details
- By Etienne ELINE

L’ordre des géomètres experts dévoile ses mesures pour concrétiser le ZAN
A l’issue des Assises Nationales de la Sobriété Foncière, l’ordre des géomètres-experts a dévoilé 17 propositions permettant de faciliter l’application du ZAN. Pour Séverine Vernet, Présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts ces mesures permettront de « faire de la lutte contre l’étalement urbain une réalité ».
L’ordre avait choisi un format original pour cette édition des assises. Celles-ci avaient lieu sur quatre territoires en même temps afin de traiter une diversité de problématiques et de solutions. La thématique « sobriété foncière en zone forestière / protection de la biodiversité » a ainsi fait l’objet de travaux spécifiques à Fort-de-France, « la sobriété foncière en zone périurbaine et rurale » était au cœur des débats à Épernay, « la sobriété foncière en zone urbaine » était étudiée à Aix-en-Provence quand la séance de La Rochelle était dédiée à « la sobriété foncière en zone littorale ».
Les 17 propositions formulées à l’issue des travaux sont les suivantes :
Définir - Soumettre au débat une définition juridique du sol en conformité avec les dispositions du Code de l'Environnement.
Connaître - Mettre en oeuvre une démarche globale et une méthodologie de connaissance des sols, de ses prévisions de mutation et de ses capacités à évoluer.
Choisir - Intégrer les sols dans le contenu de l’évaluation environnementale des documents de planification et des projets et dans les autres autorisations environnementales notamment le dossier loi sur l’eau.
Valoriser - Redonner une fonction nourricière aux sols urbanisés : « manger dès maintenant... par le sol »
Promouvoir - Informer et sensibiliser sur les sols : « les sols, la star d’aujourd’hui »
Agir - Mettre en place les dispositions financières, à l’échelle de la planification, inclure un bonus « sol » dans la Dotation Globale de Décentralisation des collectivités locales et intégrer un volet « sol » dans le cahier des charges de l’élaboration des documents d’urbanisme
Anticiper - Anticiper la renaturation des zones à risque, qu’elle soit spontanée ou du fait de l’homme et intégrer leur utilisation dans la mise en œuvre du « Nette » du ZAN.
Améliorer - Appliquer la séquence Améliorer Éviter Réduire Compenser AERC, avec le A imposé aux territoires surartificialisés (un bonus-malus inversé)
Élargir - Repenser la maîtrise d’ouvrage des opérations d’Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental (AFAFE) pour répondre aux enjeux environnementaux.
Adapter - Donner la possibilité de lancer une procédure d’AFAFE dont l’unique élément déclencheur est l’environnement pour que les Collectivités territoriales disposent d’un outil opérationnel afin de mettre ainsi en œuvre des projets environnementaux sur leur territoire.
Pérenniser - S'assurer que les aménagements environnementaux issus des procédures d’Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental (AFAFE) perdurent une fois la procédure clôturée.
Innover - Créer l’Association Foncière Urbaine de Compensation environnementale (AFU-CE) multisite.
Modifier - Modifier le contenu des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) afin de permettre une adaptativité aux opportunités foncières et recréer de véritables quartiers ou petites villes.
Densifier - Placer l’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Cœur d’îlot » au service de la densification douce des zones périurbaines.
Intensifier - Accélérer la surélévation des immeubles existants pour répondre aux enjeux environnementaux de respect du ZAN et d’isolation des bâtiments.
Adapter - Alléger et assouplir les règles de majorité applicables à la modification des cahiers des charges des lotissements existants, lorsque la décision vise à mobiliser le foncier vacant pour respecter la trajectoire de sobriété foncière.
Former - Mettre en place un parcours de formation complet et certifiant, sur les nouvelles méthodes et la vision de la ville nouvelle, et ouvert aux professionnels de la filière de l’aménagement des territoires et du cadre de vie.
- Details
- By Etienne ELINE

Arcadis dévoile son classement mondial des villes durables
La société d'ingénierie, de conseil et de gestion de projets Arcadis a révélé fin juin la 6ème édition de son classement mondial des villes durables. Le classement se base sur les sustainable developpement goals de l’ONU, rassemblant des critères humains, économiques et environnementaux, ainsi que sur les progrès réalisés par les villes dans les dernières années. Il s’agit de mettre en avant les bonnes pratiques en matière d’urbanisme durable, alors que le groupe rappelle que nous sommes à 2000 jours de l’année 2030, censée être le pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre tel que prévu par les accords de Paris.
Les villes européennes, tout particulièrement celles d’Europe du Nord et de l’Ouest, occupent une grande partie du palmarès (la première ville non-européenne, Séoul, n’arrive qu’à la 11ème place) et Paris se classe 14ème. Alors que la capitale française est reconnue pour son application de la ville du quart d’heure, la qualité de ses transports publics et de sa vie culturelle, le manque d’espace verts dégrade son score et l’empêche de rejoindre le top 10. Les deux autres villes françaises du classement, Marseille et Lyon se classent respectivement à la 31ème et à la 47ème place. Grande gagnante de cette édition, Amsterdam est saluée pour ses hauts revenus par habitant, son travail sur l’équité sociale et son investissement dans l’implémentation des énergies renouvelables.
Le Top 15 :
1. Amsterdam
2. Rotterdam
3. Copenhague
4. Francfort
5. Munich
6. Oslo
7. Hambourg
8. Berlin
9. Varsovie
10. Londres
11. Séoul
12. Stockholm
13. Edimbourg
14. Paris
15. Dublin
Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’étude et du classement sur le site d’Arcadis : https://connect.arcadis.com/sustainable-cities-index-report-2024-global?origin_url=/en/knowledge-hub/perspectives/global/sustainable-cities-index-2024
(EE)
- Details
- By Etienne ELINE

Conférence de l’OID : « La sobriété n’est pas une tendance, pas une mode, mais une lame de fond »
Le 3 juillet se tenait la conférence « Quelles sobriétés pour quel immobilier ? » organisée par l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) à l’Académie du Climat (Paris 4ème). La prise de parole inaugurale a été l’occasion pour Odile Batsère, présidente de l’OID, d’avancer que « la sobriété appartient à l’ère de la post-croissance » et pour Loïs Moulas, directeur général de l’observatoire, d’affirmer que « la sobriété n’est plus tabou mais elle relève de compréhensions différentes d’un acteur à un autre ».
La première table ronde, portant sur les imaginaires de la sobriété, a été l’occasion de rappeler que, si la sobriété est débattue en France, cela reste une exception au sein des pays de l’OCDE, quand bien même elle est presque exclusivement traitée dans l’Hexagone sous le prisme de la comptabilité énergétique alors que son sens original englobe des enjeux de redistribution des richesses et de justice sociale. Les intervenants se sont également entendus sur le fait que le mot « sobriété » ne convient pas parfaitement au concept qu’il décrit, renvoyant au sevrage de boissons alcoolisées alors que le sens qu’on veut lui donner renvoie à la tempérance, à la « suffisance » (traduction littérale du terme « sufficiency » qui s’utilise en anglais pour parler de sobriété) visant à trouver un juste milieu entre la misère et l’excès de confort.
Thierry Salomon, vice-président de l’association Négawatt, a ensuite montré les pistes qui peuvent être creusées pour une meilleure sobriété dans l’immobilier. Il s’agit d’abord de distinguer trois types de sobriété : dimensionnelle (qui prévoit une taille juste et un bon dimensionnement), d’usage (qui maximise le niveau et la durée d’exploitation) et de mutualisation (qui met en commun les usages). Dans le secteur du bâtiment, l’association estime à 30% les gains potentiels avec pas ou peu d’investissements monétaires. Cela serait rendu possible dans le résidentiel avec des économies sur le chauffage et l’eau chaude et dans le tertiaire sur la ventilation, l’éclairage ou la climatisation.
Durant la deuxième table ronde, sur les définitions et pratiques de la sobriété dans l’immobilier, Alain Resplandy-Bernard, directeur général de la Direction de l’immobilier de l’Etat, a pointé « une obligation de sobriété si on veut prendre au sérieux la transition écologique ». Celle-ci passe d’abord par une comptabilité du bilan carbone des bâtiments publics (environ deux millions de tonnes eqCO2 par an) représentant 96 millions de mètres carrés et pour lequel l’Etat a investi 4 milliards d’euros sur les cinq dernières années afin d’en rénover thermiquement une partie.
Cette volonté d’une comptabilité carbone est partagée par Astrid Weill, directrice générale de Groupama Immobilier, pour qui « on a deux poches : une avec des sous et l’autre avec du carbone. Il faut apprendre à compter avec du carbone ». Elle souligne également que pour elle la sobriété est un luxe car « le vrai luxe c’est celui qui va avec la planète ».
Céline Crestin, directrice de la stratégie et du développement responsable de Paris La Défense, a rappelé l’objectif de faire de La Défense le « premier quartier d’affaires post-carbone du monde » quand bien même celui-ci a été pensé « en dehors des cadres de la sobriété, comme un symbole de la grandeur de l’économie française moderne ». Pour elle : « être moderne c’était le principe du quartier d’affaires à l’origine, aujourd’hui on passe à autre chose ».
Il s’agit également pour Julien Pemezec, directeur général de Woodeum x Pitch Immo, de viser d’autres modèles. Assumant que l’industrie a été « mauvaise élève » sur la sobriété, il rappelle « qu’il a dix ans on ne savait même pas mesurer le carbone et on ne savait pas où faire la chasse aux économies de carbone ». Il s’agit maintenant d’appliquer des solutions sur la base des nouvelles connaissances à notre disponibilité car « demain on ne nous laissera plus construire si on ne fait pas l’effort maintenant ».
Etienne Eline
- Details
- By Etienne ELINE

À quoi pourrait ressembler l’habitat collectif de demain?
Les lauréats de la première édition du Prix européen pour le logement collectif ont été reçus le 20 juin au centre d’architecture bordelais Arc en rêve pour recevoir leur récompense. Une exposition leur sera consacrée cet automne à l’Institut d’architecture du Pays basque de Saint-Sébastien (Espagne), puis au centre Arc en rêve.
- Details
- By Théo LE FRANC
Page 6 of 18